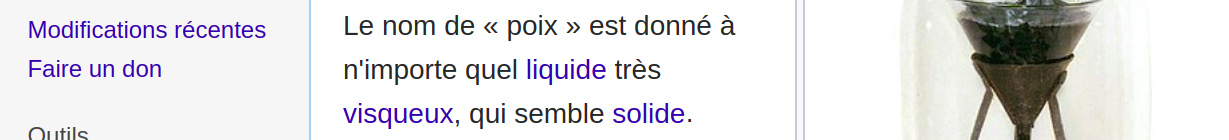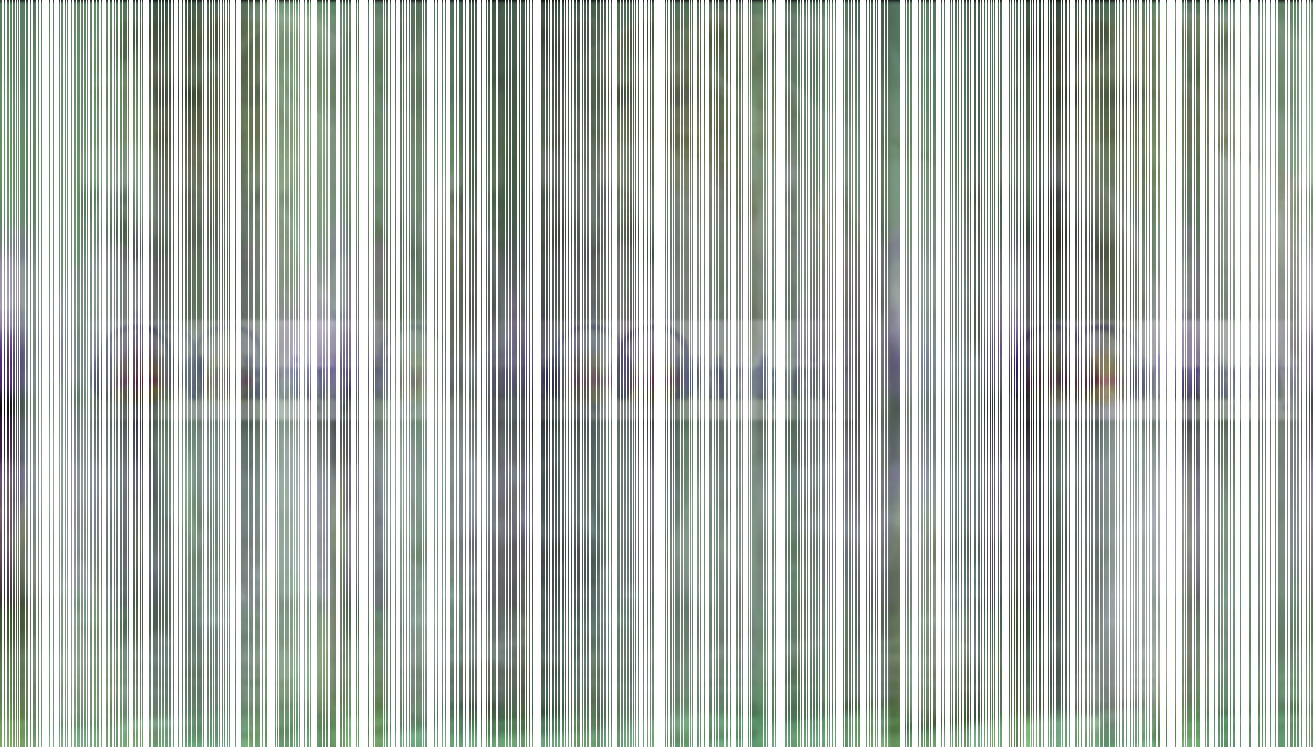(Compte-rendu d’une conversation collective parue dans Legovil 4)
Impayés. Recouvrement. Trier puis agir. Mettez en place un classement de vos débiteurs en trois groupes et instituez un traitement différencié pour chacun d’eux. L’efficacité globale de votre recouvrement en sera ainsi accrue.
1. Il peut et il veut. Négligence, retard, erreur du débiteur, qui effectue le paiement. Tout rentre dans l’ordre. Votre appel téléphonique vous a fait économiser des frais d’avocat et / ou d’huissier.
2. Il veut, mais ne peut pas. Votre débiteur rencontre d’incontestables difficultés financières, mais ne conteste pas sa dette. Cette catégorie de dossier pose un redoutable problème. Concilier rapidité (car la situation peut se dégrader et le débiteur devenir totalement insolvable…) et gestion du rapport entre le coût du recouvrement et les sommes recouvrées (pour ne pas en plus perdre de l’argent). C’est pourquoi, dans ces dossiers, il est souvent opportun de négocier un paiement échelonné. A défaut de paiement, faites le point avec votre expert comptable. Provision en défaut de paiement ; éventuellement : récupération de la TVA déjà reversée au Trésor. Constituez-vous un bon dossier prouvant les difficultés de recouvrement de votre créance. Copie des relances et des rappels infructueux.
3. Il peut mais ne veut pas. Pas de souci financier en ce qui le concerne, mais il estime être en mesure de refuser de payer. Au-delà de la négociation, face à ce type de client, vous serez peut-être amené à entamer une procédure. Plusieurs possibilités sont ouvertes selon la nature du motif du refus de payer, à étudier avec votre avocat et votre huissier. Pour cette catégorie de dossier, le coût d’éventuelles procédures judiciaires n’est pas à comparer avec les chances de recouvrement mais avec les chances de succès, c’est-à-dire avec la qualité des motifs de refus de payer.
Rangez votre débiteur dans une des trois catégories précédentes. Agissez en conséquence.
(« Avis & Conseil Entreprises »,
14 mars 2006)

Sur l’image ci-dessous, nous avons une représentation graphique inexacte de la typologie d’Avis & Conseil Entreprises. Inexacte, puisque l’item original « il peut et il veut » a été remplacé – inattention ou geste critique ? – par « il veut et il peut ». De plus, notre typologie, mais cette fois au même titre que l’originale, est incomplète. Une typologie complète des débiteurs distinguerait, au point de vue logique, les énoncés en fonction de la place qu’y occupent les verbes déontiques :
Il peut et il veut. ≠ Il veut et il peut.
Il veut mais ne peut pas. ≠ Il peut mais ne veut pas.
Il ne veut pas mais peut. ≠ Il ne peut pas mais veut.
Il ne peut pas et ne veut pas. ≠ Il ne veut pas et ne peut pas.
À ces énoncés on pourrait en ajouter d’autres, sur la base d’une interprétation différenciée des conjonctions et et mais.
Il peut mais il veut. ≠ Il peut et il veut.
Il veut mais il peut. ≠ Il veut et il peut.
Il veut et ne peut pas. ≠ Il veut mais ne peut pas.
Il peut et ne veut pas. ≠ Il peut mais ne veut pas.
Il ne veut pas et peut.≠ Il ne veut pas mais peut.
Il ne peut pas et veut. ≠ Il ne peut pas mais veut.
Il ne peut pas mais ne veut pas. ≠ Il ne peut pas et ne veut pas.
Il ne veut pas mais ne peut pas.≠ Il ne veut pas et ne peut pas.
En algèbre, l’opérateur ‘mais’ conjoint une enveloppe (sommation) et sa négation, soit :
mais = ‘et’ et ‘non’
Cette conjonction n’est pas un gain sec, mais une complication du crédit.
Notons tout de même, quelle que soit la typologie considérée, l’absence du verbe devoir du jeu des déontiques ; c’est que, comme sur les Tables de la Loi (thou shall not kill, du sollst nicht töten…), devoir est tutélaire : nulle dette ne se pense sans un devoir premier. Le poids de la dette est en effet une expression de la gravitas (pour un parallèle avec le poids du péché, se rapporter à Swedenborg, La nouvelle Jérusalem et sa doctrine céleste, la repentance et la rémission des péchés, 1821, §166). Par souci de clarté, rendons visible l’ombre portée de devoir sur vouloir et pouvoir :
Il doit, veut, et peut.
Il doit, veut, mais ne peut pas.
Il doit, peut, mais ne veut pas.
La tutelle rendue patente, profitons-en pour mentionner une autre évidence, qui, à force de flotter, s’oublie peut-être : les déontiques ont ici une valeur auxiliaire. Ils sont au service d’une modalisation d’un unique verbe, qui indique l’horizon résolutif (et rémissif) du problème de la dette : payer (remettre). Soit :
i) Il doit payer (remettre), veut payer (remettre), et peut payer (remettre).
ii) Il doit payer (remettre), veut payer (remettre), mais ne peut pas payer (remettre).
iii) Il doit payer (remettre), peut payer (remettre), mais ne veut pas payer (remettre).
En outre, l’objet du paiement, si on le rétablit, ferme tautologiquement chaque proposition, puisque, en général, ce que le débiteur doit payer, ça n’est rien d’autre que ce qu’il doit. Soit :
i) Il doit payer ce qu’il doit, veut payer ce qu’il doit, et peut payer ce qu’il doit.
ii) Il doit payer ce qu’il doit, veut payer ce qu’il doit, mais [‘et’ et ‘non’] ne peut pas payer ce qu’il doit.
iii) Il doit payer ce qu’il doit, peut payer ce qu’il doit, mais [‘et’ et ‘non’] ne veut pas payer ce qu’il doit.
Il faut particulièrement insister sur le fait que, du point de vue du créditeur lancé dans l’échelle des démarches – du simple coup de téléphone à l’envoi d’un huissier pour entame d’une procédure de recouvrement – l’horizon résolutif se dit dans une actualisation qui, en dernier lieu, annule toutes les modalisations :
Il va payer.
Propitiation ? Pas si sûr. Le créditeur a la main sur sa créature débiteuse. Il peut – par exemple à l’égard du second débiteur – faire preuve de mansuétude. En effet, du point de vue du créditeur, alors que les débiteurs 1 et 3 vont payer ce qu’ils doivent, le débiteur 2 bénéficie d’une rémission négociée : il va payer ce qu’il peut, comme il peut. Cette indulgence à l’égard du deuxième type de débiteur est une prime donnée à l’innocence du vouloir. L’innocence du vouloir entraîne une culpabilité partielle, puisqu’elle procède d’un empêchement, d’une limitation du pouvoir. Le débiteur 2, en tant qu’empêché, est un honnête pécheur ou un tricheur sincère. Il convient de l’aider à retrouver le droit chemin.
La banque me dit allez voir les flics. Je vais voir les flics. Ils me disent allez voir les impôts. Je vais voir les impôts. Ils me disent allez voir la banque. Je vais voir la banque. La banque me dit allez voir les flics. Après quelques tours, j’arrive à m’expulser du manège et je tombe sur le bonhomme Voilà, l’huissier. Il est tellement heureux de tomber sur une bonne foi qu’il se montre immédiatement arrangeant,réduit la facture et débloque mes comptes. Il récompense mon non-ménagement. Il me paie mes tours de manèges.
« Votre débiteur rencontre d’incontestables difficultés financières, mais ne conteste pas sa dette. Cette catégorie de dossier pose un redoutable problème. »
Les difficultés sont incontestables, la dette frontale et aveuglante, le problème difficile : la situation est en ce sens tragique. La bonne conscience prend le tour de la torpeur et de la contrition. Rien ne garantit la réminiscence. « Pour assurer le retour de la réminiscence, il faudrait repartir de l’amorce de sens qu’elle autorise. » (M. Richir, Fragm. Phénom. Tps & Esp., 150). C’est pourtant ce détachement au Sens qui surprend… « La réminiscence franchit le Sens par exception, dans la surprise. » (Ibid., p.151). Si l’impossibilité de payer est ainsi vécue sur le mode de la surprise inquiète, la personne est jugée respectable. L’innocence du deuxième débiteur du point de vue de l’intention, l’innocence de son vouloir, est un élément qui ne desserre pas, lui, le nœud tragique, mais contribue au contraire à le nouer davantage : il y a contradiction du vouloir et du pouvoir. Le conflit devient conflit des forces et des intérêts.
La contradiction tragique du vouloir et du pouvoir est engagée : on voudrait par exemple marier une femme, mais [‘et’ et ‘non’] accéder à ce désir ferait de nous [de la personne entière, non fragmentée par la surprise inquiète] l’ennemi du père, soit – par alliance – l’ennemi héréditaire du père. Il y a une totalité circulaire du problème, une inextricabilité du nœud qui oblige à une analyse plus approfondie. On ne peut pas diviser le problème. Il n’est pas ici question de marchandise, mais de l’objet dans son sens le plus hautement métaphysique : son caractère centralisateur (dont la forme politiquement manifeste se traduit dans l’errance relative autour de la définition de l’ennemi). Le différend économique est une relation politique sans sujet, la pire de toutes parce que la plus implacablement irréductible au circuit de la médiation. L’aboutissement tragique est alors : « totalement insolvable ». La totale insolvabilité du débiteur est le moteur de l’action et son minuteur : il faut agir vite, s’organiser rapidement (pour résister à l’oubli et l’entropie des engagements).
Face au deuxième débiteur, la mise en place d’un échelonnage des remboursements est une façon de découper le noeud, de diviser le problème tragique, de réintroduire une échelle et ses variables hypostatiques. L’horloge discrète du temps échéant se met à tourner légèrement moins vite. Une occasion est offerte de quitter la tragédie pour entrer dans l’espace logique du drame : la tragédie était la convergence fatale des moyens insuffisants et des fins nécessaires, le drame est ce qui se résout quand on met les moyens. On passe de la surprise inquiète au convoi de la négociation.
À quel moment des rapports historiques entre drame et tragédie se trouve-t-on ? Quel est notre rapport à la dette ? La tragédie trouve son aboutissement déjà prescrit dans l’insolvabilité radicale du débiteur, ergo sa liquidation, sa mort en tant que puissance financière et source d’argent. Dans le drame, peut encore se nouer un problème – notamment celui du handicap douloureux du débiteur. La position du problème nous fait passer de la pure angoisse relative à la forme de l’oubli dans l’expérience plus modérée de la perte d’historicité. Quand tu es en état d’insolvabilité, tu es dans la stupeur, alors que quand tu rentres dans le circuit de la médiation du remboursement, tu es juste dans une aliénation relative qui se manifeste comme une perte d’historicité – l’Histoire étant l’élément relatif du drame, par opposition à la transgression tragique comme situation absolue. L’inter-dit supplante le non dit.
Si le débiteur peut mais ne veut pas – cas de figure numéro 3 – les moyens à déployer pour le contraindre sont déjà connus : il faut toucher aux propriétés qui seraient naturellement celles du drame de la saisie. Le deuxième débiteur, lui, tend à échapper à la possibilité de la saisie.
Le seul, dans cette typologie, qui soit coupable totalement, c’est le débiteur numéro 3 : il l’est au plan du vouloir et au plan du pouvoir. C’est le seul à commettre un crime caractérisé, et à appeler une réponse procédurale. Il n’est pas aimable ; on ne traitera pas avec lui à l’amiable. L’abandon du mauvais axe, du mauvais pivot relève d’une question de principe.
« Nous connaissons les gens qui ont des combines pour échapper aux manoeuvres de la machine de recouvrement et de l’échéancière gracile. Nous savons quel est le traitement à leur faire subir. »
Cette
société du Gabon
à qui il était demandé
, par la justice,
3906 € d’impayés.Une lettre lui est envoyée,
comme des pigeons à la figure.
La magnanimité colon n’est plus ; reste
le complexe postcolonial :
On n’a plus l’Empire et en plus,
ils nous la mettent
à l’envers.
forme libidinale de la dette et mort de danton
– Et toi, pourquoi tu t’intéresses tant, par exemple quand tu parles des créditeurs, à la libido ? Tu dis « la jouissance » comme si tu faisais un poème ou un avis & conseil entreprises.
– Je ne saurais pas en parler avec précision, mais je crois qu’on a affaire à deux choses. On a affaire à un système. Le système, c’est la typologie du conseil & avis entreprises. Des espèces de fabrication de fils invisibles qui nous tiendraient, et puis en fait quand on a affaire à un humain : qu’il soit huissier, qu’il soit machin, il est encore humain, c’est-à-dire qu’il fait son travail, comme on dit. Et peut-être c’est ça l’espace de la jouissance : faire plus son travail qu’être encore son métier. Walser, à chaque fois qu’il trouvait du boulot – des trucs à la Bartleby : recopier des textes, avec une journée entière pour recouvrer un seul texte – tu vois, à chaque fois Walser il fait son boulot super bien,avec ardeur et zèle, et le lendemain ça l’emmerde, tout à coup il ne fait plus rien, il fait défection mais à son poste, et le surlendemain il quitte son poste. Il va retrouver un autre boulot où reproduire le même schéma : jouir, ne rien faire, voilà. Dans l’amour, pareil : il va faire le ménage chez une femme, et cette femme a des grandes chaussures avec des talons extraordinaires. Il rêve de lui baiser les pieds, d’être le plus bas possible devant celle qui l’embauche. Il jouit de la désirer sublime ; il la déteste d’être si laide ; il quitte l’emploi de la désirer ou de la haïr.
– Alors Walser, c’était une sorte de sub capricieux ?
– Oui. Dans Le Commis, dès les premières lignes, il est fait droit au personnage principal, un commis, qui exige qu’on lui produise les conditions optimales pour s’accomplir comme commis.
– Il veut rencontrer sa jouissance. Sauf qu’après, sa liberté, ce sera celle de tout casser…
– Recouvrer la liberté… Débiter n’importe quoi, c’est-à-dire parler sans jamais s’acquitter d’une dette vis-à-vis du langage. Tout casser, c’est alourdir sa dette.
– Je notais hier le verbe « désintéresser ». Désintéresser, c’est : faire cesser l’attente.
– Être désintéressé, c’est avoir totalement remboursé sa dette, c’est ça ? C’est un terme technique ?
– Oui… Non… C’est peut-être moi ça… Faire cesser l’attente, ne plus importer. Être léger de toute dette, avoir disparu…
– On ne s’est pas trop intéressé à la figure de « il peut et il veut ».
– Oui. Il est enregistré comme débiteur accidentellement. Il a oublié…
– Il est juste à la bourre, oui. On n’a pas trouvé son adresse, quoi. Il est en retard sur le temps.
– Alors je pense qu’on touche à un point important. L’homme qui a énoncé la fin historique de la tragédie et annoncé le temps où règne seul le drame interminable, c’est un Allemand, il s’appelle Büchner, et c’est dans un texte qui s’appelle La mort de Danton.
– De ce point de vue, il faudrait peut-être à nouveau questionner les rapports entre tragédie et drame. Il s’agit d’imaginer une échelle sur laquelle on distingue les événements, d’une part (soudain…, c’est alors que…), des certitudes (il est bien entendu que…), d’autre part.
– Alors, là, il y a un truc à noter ? La mort ?
– Oui…
– Au regard de la dette ?
– Au regard de la dette. Ce que serait la mort pour un regard drama doit être précisé.
– Est-ce que Danton est coupable ou innocent dans la pièce de Büchner ?
– Ce n’est plus la question, justement. Ou plutôt : l’innocence n’est plus ici en question.
– La question morale a été liquidée ?
– La question tragique a été liquidée.
– J’ai ramené un filet, je ne sais pas pourquoi. Je suis vivant dans l’écarté. J’arrive, je vois un filet, je me dis « c’est le débiteur son filet », ou « le recouvreur son filet ». Il me semble que la cessation des temps propres à la surprise inquiète est aussi l’occasion d’une centration de l’échelle sous la forme d’une toile, par exemple. J’ai appris dans la dette qu’il était question de capture jusqu’en dehors d’elle.
Il y avait ce
Monsieur espagnol,
robin des bois des banques
qui enchaînait les crédits pour la cause
anticapitaliste.Il édite un journal avec de l’argent
qu’il n’a pas. Dans ce journal,
il décrit les méthodes pour
financer la cause qu’on a
avec de l’argent qu’on n’a pas.